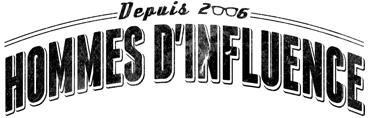- Dim Nov 11, 2007 7:13 pm
#23851
Le collier de griffes de Charles Cros (célèbre chimiste qui vécu de 1842 à 1888) contient une prose nommée La science de l'amour qui présente des analogies amusantes et quelques-fois surprenantes avec la communauté de la séduction actuelle. Pour pallier à tout anachronisme, le texte est à replacer dans le contexte de l'expérimentation du XIXe siècle. Il a en effet été écrit en 1884 pour une publication posthume en 1908.
Il peut être mis en parallèle avec L'ève future de Villiers de l’Isle-Adam sur certains de ses aspects.
Le texte reproduit ici provient du site http://www.florilege.free.fr
[quote]
La Science de l’amour
Très jeune, j’eus une belle fortune et le goût de la science. Non de cette science en l’air qui, prétentieuse, croit pouvoir créer le monde de toutes pièces et voltige dans l’atmosphère bleue de l’imagination. J’ai pensé toujours, d’accord avec la cohorte serrée des savants modernes, que l’homme n’est qu’un sténographe des faits brutaux, qu’un secrétaire de la nature palpable ; que la vérité conçue non dans quelques vaines universalités, mais dans un volume immense et confus, n’est abordable partiellement qu’aux gratteurs, rogneurs, fureteurs, commissionnaires et emmagasineurs de faits réels, constatables, indéniables ; en un mot qu’il faut être fourmi, qu’il faut être ciron, rotifère, vibrion, qu’il faut n’être rien ! pour apporter son atome dans l’infinité des atomes qui composent la majestueuse pyramide des vérités scientifiques. Observer, observer, surtout ne jamais penser, rêver, imaginer ; voilà les splendeurs de la méthode actuelle.
C’est avec ces saines doctrines que je suis entré dans la vie ; et, dès mes premiers pas, un projet merveilleux, une vraie aubaine scientifique m’est venue à l’esprit.
Quand j’apprenais la physique, je me suis dit :
On a étudié la pesanteur, la chaleur, l’électricité, le magnétisme, la lumière. L’équivalent mécanique de ces forces est ou sera sans conteste déterminé d’une façon rigoureuse. Mais tous ceux qui travaillent à l’expression de ces éléments du savoir futur n’ont dans le monde qu’un piètre rôle.
Il est d’autres forces que l’observation sagace et patiente doit soumettre à l’esprit du savant. Je ne ferai pas de classifications générales, parce que je les considère comme funestes à l’étude et que je n’y entends rien. Bref, j’ai été amené (comment et pourquoi, je ne sais pas) à entreprendre l’étude scientifique de l’amour.
Je n’ai pas un physique absolument désagréable, je ne suis ni trop grand ni trop petit, et personne n’a jamais affirmé que je fusse brun ou blond. J’ai seulement les yeux un peu petits, pas assez brillants, ce qui me donne un aspect d’hébétude utile dans les sociétés savantes, mais nuisible dans le monde.
De ce monde, d’ailleurs, malgré tant d’efforts méthodiques, je n’ai pas une connaissance bien nette, et c’est un vrai chef-d’œuvre de sang-froid que d’y avoir pu, sans attirer l’attention, poursuivre mon but austère.
Je m’étais dit : Je veux étudier l’amour, non comme les Don Juan, qui s’amusent sans écrire, non comme les littérateurs qui sentimentalisent nuageusement, mais comme les savants sérieux. Pour constater l’effet de la chaleur sur le zinc, on prend une barre de zinc, on la chauffe dans l’eau à une température rigoureusement déterminée au moyen du meilleur thermomètre possible ; on mesure avec précision la longueur de la barre, sa ténacité, sa sonorité, sa capacité calorique, et on en fait autant à une autre température non moins rigoureusement déterminée.
C’est par des procédés aussi exacts que je me proposai (projet remarquable à un âge si tendre — vingt-cinq ans à peine) d’étudier l’amour. Difficile entreprise.
Généralement, je ne sais par quelle répugnance gênante et même coupable les gens amoureux se soustraient obstinément à tout examen scientifique ; et cela particulièrement dans les instants où l’examen serait fructueux. Ceci acquis, mon plan fut bien vite arrêté.
Pour étudier l’amour, me dis-je, il faut prendre le meilleur poste d’observation. Le confident le plus intime est congédié lors des minutes caractéristiques. Il n’y a que les meubles, quelquefois un chien, un chat, qui assistent à ces mystères qu’une inexplicable fatalité a dérobés jusqu’ici à l’analyse. Je n’ai donc qu’une ressource, c’est de jouer personnellement le rôle d’amoureux.
N’ayant guère de charmes, vu que le peu qui m’en avait été accordé par la nature s’était étiolé à l’ombre des bibliothèques et aux odeurs des laboratoires, j’eus recours à mon profond savoir pour me rendre digne des rêves féminins.
Oh ! les merveilleux cosmétiques, rouge puéril insoluble, noir bleuâtre des yeux sans sommeil, huiles pour rendre la peau diaphane, galvanisations pour me donner du galbe aux jambes, que j’ai inventés, à cette époque ! Mais je n’étais pas assez naïf pour compter seulement sur l’aspect de ma physionomie, sur l’allure de ma personne. Il me fallait apprendre à fond ces riens charmants qui séduisent les jeunes filles, ces futilités ridicules qui nous soumettent le beau sexe.
J’allai trouver Chopin et lui demandai :
« Vous avez beaucoup joué du piano dans le monde. Quelle est la musique qui plaît le plus aux femmes ? »
Il me répondit sans hésiter : « La Rêverie de Rosellen. »
— Quarante mille francs, si vous voulez m’enseigner à jouer parfaitement cette rêverie.
Chopin, ridiculement impratique, se récusa et me recommanda M. K***, un de ses élèves, comme plus fort que lui-même (ce qui était reste vrai). M. K*** accepta les quarante mille francs, et, probe, m’apprit uniquement à jouer la Rêverie de Rosellen.
J’étais armé de ce côté.
J’allai trouver Musset et lui demandai : « Quelle est la poésie plaît le plus aux femmes ? »
Musset posa l’index sur le sourcil et me dit : « L’Acrostiche. »
— Voici cinquante mille francs, apprenez-moi l’Acrostiche.
Musset, bohème indécrottable, ne comprit pas que j’étais sa providence et me renvoya à M. W*** (je ne veux pas révéler son nom), élève que je trouve bien plus fort que son maître.
W*** prit les cinquante mille francs et me fit une exquise collection d’acrostiches, sur tous les noms du martyrologe féminin. Chaque nom avait trois versions, blonde, brune et châtaine. Il y eut en outre promesse écrite de livraison pour les cas imprévus. Ainsi muni, j’entrai résolument dans le monde.
Après de nombreux insuccès (tant il est vrai qu’on n’apprend rien que par expérience), insuccès inutiles à raconter, je trouvai enfin mon affaire. Ce fut dans une famille habitant le Marais, dans un de ces vieux hôtels de président du Parlement.
Tout le premier étage servait de magasin de papier, et par le grand escalier de pierre à rampe patiemment forgée on montait d’interminables marches jusqu’à l’étage supérieur, où habitait M. D*** et sa famille. L’aspect honnête, oublié, de cette maison me plut tout d’abord la première fois que j’y vins.
M. D*** avait cédé au mari de sa fille aînée le magasin de papier d’au-dessous. Autrefois, la plume à l’oreille et l’œil aux ballots, il y avait acquis une fortune assez ronde pour assurer une dot raisonnable à sa fille cadette, tout en se gardant de quoi irriter les espérances de ses gendres.
On recevait tous les samedis. De toutes petites réceptions, thé, petits gâteaux, etc. C’était pour marier la fille qu’on se livrait à ces joies simples, et qu’en outre, les autres soirs de la semaine, on promenait ladite fille dans toutes les maisons du même monde. J’avais parcouru un nombre immense de ces intérieurs, sautant consciencieusement au bruit des polkas et des quadrilles que les mamans complaisantes font suinter de leurs doigts mous. Comme on me rencontrait partout, je sus me faire inviter chez M. D***. J’avais déterminé, par une suite d’examens comparatifs, que la complexion de Mlle D*** était, plus que celle de toute autre jeune fille proposée, convenable à mes projets.
La position était excellente. On me recevait en vue d’un mariage possible ; on faisait donc attention à moi, on me mettait en relief, adroitement, de manière à ne pas rebuter le caractère peut-être fantasque de la jeune personne.
Mais j’avais mon plan arrêté. Comme il est de notoriété ancienne que le mariage n’a aucun rapport avec l’amour, il fallait manœuvrer pour éviter cette conclusion désastreuse qui m’avait déjà été offerte souvent et que j’avais fuie, non sans me compromettre un peu.
Je commençai donc par donner quelques conseils à la mère au sujet de son embonpoint exagéré, cela dans les limites de la politesse la plus exquise et même de la plus candide bienveillance, bien entendu.
Ces conseils lui firent prendre une voix aigre-douce et provoquèrent une profession de foi politique pour laquelle je pris quelques réserves. Je m’en tins là cependant, ne voulant pas hâter les choses, et je me mis à causer, l’air un peu triste et préoccupé, avec la demoiselle. Je m’arrêtais au milieu de phrases dont le diable, pas plus que moi, n’eût trouvé la suite :
« Il y a des cas où l’âme doit planer au-dessus des complexités... »
Ou bien :
« Le cœur est un esclave dont la chaîne... Le cœur est un esclave qui ne saurait obéir..., etc. »
Puis, après un soupir, j’allais m’asseoir au piano et l’irrésistible Rêverie de Rosellen me valait de délicieux regards de soumission par-dessus l’épaule de la jeune personne versant le thé.
Elle s’appelait Virginie et était châtaine. Ma collection d’acrostiches contenait ce cas particulier sous la forme qu’on va lire :
Vous ne connaissez pas tous nos rêves de fièvre
Indomptable où le feu qui brûle notre lèvre
Rend la vie impossible en ces salons railleurs.
Grâce pourtant à vos regards (j’en suis comme ivre,
Ivre d’azur profond), je me reprends à vivre,
Naïf, aimant les bois. Si nous étions ailleurs,
Il faudrait oublier famille, honneur, patrie,
Et penser que je suis tout cela, ma chérie.
Ces vers, corrigés par mon ami le poète W*** d’après la situation, se prêtaient merveilleusement à mes projets de détournement. Dès que je les eus adroitement glissés dans la main droite de Virginie, la pauvrette fut désormais soumise à ma puissance.
Un soir, en prenant ma tasse de thé, je pressai ses petits doigts par-dessous la soucoupe. Émotion, ou peut-être intention de ma part, la tasse tomba, se cassa sur le coin du piano, et le thé bouillant, sucré, avec son nuage de lait, inonda mon superbe pantalon gris perle.
« Maladroit que je suis ! dis-je en palissant sous la brûlure, insignifiante du reste. Je vous ai perdu votre robe, mademoiselle.
— Tu n’en fais jamais d’autres, Virginie, dit la mère.
— Madame, je vous assure que c’est moi, en posant la tasse sur le bord du piano...
— D’ailleurs, la bonne peut offrir le thé et les sirops. »
La jeune fille disparut. Oh ! si j’avais pu assister à la nuit qu’elle dut passer !
Bref, je pondérai si bien mes faits et gestes que la froideur des parents crût exactement comme l’amour de la fille. Subséquemment j’eus des mots à voix basse avec celle-ci : elle était malheureuse, ses parents me détestaient... il fallait les ménager, etc.
J’ai l’air de faire du roman, mais on se tromperait en me croyant une pareille légèreté d’esprit. Ce que j’ai dit, aussi brièvement que possible, était nécessaire. Maintenant la science proprement dite commence.
Nous échangeâmes nos portraits. Le mien était photographié sur émail, encadré d’or, avec une chaînette minuscule, pour être porté sous les vêtements.
Ce portrait contenait, cachés entre une plaque d’ivoire et l’émail deux thermomètres à maxima et à minima, deux chefs-d’œuvre de précision sous des dimensions si petites.
Ainsi je pouvais vérifier les modifications à la température normale d’un organisme affecté d’amour.
Sous des prétextes souvent difficiles à inventer, je me faisais rendre pour quelques heures le portrait, je prenais note des nombres à leur date et j’amorçais de nouveau les thermomètres.
Un soir que j’avais dansé deux fois avec une petite dame brune, je me rappelle avoir constaté un abaissement de température de quatre dixièmes, suivi ou précédé (rien ne m’a fait connaître l’ordre des phénomènes) d’une élévation de sept dixièmes. Voilà des faits.
Quoi qu’il en soit, tout étant préparé, je pris les mesures suivantes. Je dis à M. D*** : « La propriété, c’est le vol » (ce n’est pas de moi, ce n’est pas neuf, mais ça porte toujours) ; à Mme D*** qui avait fait une fausse couche dont elle parlait trop souvent : « La femme, au point de vue économique et social, peut et doit être considérée comme une usine à fœtus » et je fredonnai, sur l’air Près d’un berceau, quelques vers d’une chanson de W*** intitulée : Près d’un bocal :
... Je le voyais en blanc faux col
Frais substitut aux dignes poses...
S’il n’était pas dans l’alcool,
Comme il eût fait de grandes choses !
Puis j’insinuai dans la main de Virginie ce billet :
« Je vous expliquerai tout, après. Brouille absolue entre vos parents et moi. L’idéal, le rêve, le prisme de l’impossible, voilà ce qui nous attend. Pour vivre il faut aimer... Il y a une berline en bas : viens, ou je me tue et tu es damnée. »
C’est ainsi que je l’enlevai.
Les facilités que j’avais trouvées dans cette entreprise me stupéfiaient, lorsqu’en chemin de fer je regardais cette jeune fille, élevée tranquillement, destinée peut-être à quelque employé médiocre, et qui me suivait à la faveur d’une série de formules sentimentales, que je n’avais pas inventées, du reste, et que vraiment j’expliquerais insuffisamment.
Nous allions quelque part, on le suppose.
J’avais en effet depuis longtemps préparé, avec ma sagacité personnelle, une délicieuse et méthodique installation dont le but apparaîtra ci-dessous.
Il y avait trois heures de chemin de fer, beaucoup de temps pour l’effarement, les sanglots, les palpitations. Heureusement que nous n’étions pas seuls dans le compartiment.
J’avais préalablement étudié, autant qu’il se peut, la situation dans les romans :
« Tu... Vous me sacrifiez tout.. Comment reconnaître... » Puis après un silence : « Je t’aime, je vous aime... Oh ! les voyages avec la bien-aimée ! L’horizon rougit le soir, ou le matin s’emperle à l’aurore, et l’on est tous deux face à face, après la distraction ou le sommeil, dans des pays à parfums nouveaux. »
Je m’étais fait faire la phrase par mon ami le poète W***.
Nous arrivons, elle comme un oiseau mouillé, moi ravi du succès initial de mes recherches. Car, sans me laisser entraîner à la vanité romanesque de cet enlèvement, j’avais durant tout le voyage, en rassurant la pauvre jeune fille effarouchée, adroitement appliqué entre sa dixième et sa onzième côte un cardiographe à fonctionnement prolongé si exact que M. le Docteur Marey, à qui j’en dois la description idéale se l’était refusé par économie.
Puis, une voiture nous prit à la gare. Terreur, embarras, ivresse inquiète de la demoiselle. Faiblement repoussés, mes embrassements permettaient au cardiographe d’enregistrer les expressions viscérales de la situation.
Et dans le délicieux boudoir où, mettant ses mains sur ses yeux, elle se reprochait sa rupture définitive avec les exigences de la morale et de l’opinion, je pus heureusement procéder à la détermination exacte (le moment était d’absolue importance) du poids de son corps. Voici comment :
Elle s’était laissée aller sur un sofa, perdue en ses pensées. M’arrêtant, ému, ravi de la contempler, je pressai du talon un bouton de sonnerie électrique ménagé sous le tapis, et, à côté, dans un cabinet secret, au bout du levier de bascule dont le sofa occupait l’autre bout, Jean (domestique dévoué et prévenu) put constater le poids de la demoiselle habillée.
Je me jetai à côté d’elle et je lui prodiguai toutes les consolations possibles, caresses, baisers, massage, hypnotisme, etc., consolations pourtant non définitives, vu mon plan de recherches.
Je passe sur les transitions qui m’amenèrent à faire tomber ses derniers vêtements, toujours sur le sofa, et à l’emporter dans l’alcôve où elle oublia famille, opinion, société.
Pendant ce temps-là, Jean pesait les habits laissés, bas et bottines compris, sur ledit sofa, de manière à obtenir par soustraction le poids net du corps de la femme.
D’ailleurs, dans la chambre où, ivre d’amour, elle s’abandonnait à mes transports fictifs (car je n’avais pas à perdre mon temps), nous étions comme dans une cornue. Les murs doublés de cuivre empêchaient tout rapport avec l’atmosphère ; et l’air, à son entrée d’abord, à sa sortie ensuite, était analysé d’une manière rigoureuse. Les solutions de potasse des appareils à boule révélaient, heure par heure, à d’habiles chimistes la présence quantitative de l’acide carbonique. Je me souviens de nombres curieux à ce sujet, mais ils manquent de la précision justement exigée dans les tables, puisque ma respiration à moi, non amoureux, était mêlée à la respiration de Virginie, vraie amoureuse. Qu’il me suffise de mentionner en gros l’excès d’acide carbonique lors des nuits tumultueuses où la passion atteignait ses maxima d’intensité et d’expression numérique.
Des bandes de papier de tournesol habilement distribuées dans les doublures de ses vêtements m’ont révélé la réaction constamment très acide de la sueur. Puis les jours suivants, puis les nuits suivantes, que de nombres à enregistrer sur l’équivalent mécanique des contractions nerveuses, sur la quantité de larmes sécrétées, sur la composition de la salive, sur l’hygroscopie variable des cheveux, sur la tension des sanglots inquiets et des soupirs de volupté !
Les résultats du compteur pour baisers sont particulièrement curieux. L’instrument, qui est de mon invention, n’est pas plus gros que ces appareils que les bateleurs se mettent dans la bouche pour faire parler Polichinelle, et qu’on désigne sous le nom de pratique. Dès que le dialogue devenait tendre et que la situation s’annonçait comme opportune, je mettais, en cachette, bien entendu, l’appareil monté entre mes dents.
J’avais eu jusque-là assez de dédain pour ces expressions de « mille baisers » qu’on met à la fin des billets amoureux. Ce sont, me disais-je, des hyperboles passées dans la langue vulgaire, d’après certains poètes de mauvais goût, comme Jean Second, par exemple. Eh bien, je suis heureux d’apporter une vérification expérimentale à ces formules instinctives que bien des savants avaient, avant moi, considérées comme absolument chimériques. Dans l’espace d’une heure et demie à peu près, mon compteur avait enregistré neuf cent quarante-quatre baisers.
L’instrument placé dans ma bouche me gênait ; j’étais préoccupé de mes recherches, et d’ailleurs les activités feintes n’égalent jamais les réelles. Si l’on tient compte de tout cela, on verra que ce nombre de neuf cent quarante-quatre peut être souvent dépassé par les gens violemment amoureux.
Cette exquise période de bonheur pour elle et de fructueuses études pour moi dura quatre-vingt-sept jours. J’avais établi la série de faits décisifs sur lesquels la science de l’amour doit nécessairement se fonder, sauf la neuvième et dernière partie dans ma subdivision. Cette neuvième partie a pour titre : Les effets de l’absence et du regret.
L’étude devenait délicate ; heureusement que je pouvais compter sur Jean (domestique dévoué) et sur mes fidèles préparateurs, physiciens, chimistes, naturalistes.
« Virginie, dis-je donc un matin, rêve bleu de ma vie, étoile de mon avenir blafard, j’ai oublié dans tes bras quelques billets à ordre qu’on a protestés. Je dois donc momentanément me soustraire aux lueurs de tes yeux, au magnétisme de tes baisers, à l’éblouissement de tes étreintes, et aller laver cette tache de ma vie commerciale. »
La scène qu’elle me fit compléta ce que j’avais déterminé dans quelques scènes précédentes relativement au Mécanisme du dépit.
Et je partis, inflexible, non sans laisser des instructions précises à tous mes préparateurs pour qu’ils prissent les dernières notes nécessaires à mon mémoire, dont l’effet académique s’annonçait désormais comme devant être foudroyant.
À dire vrai pourtant, j’étais fatigué de ces recherches si patientes. Quand un chimiste étudie avec la plus grande ferveur un genre de réactions, une théorie générale, il peut du moins, aux heures de repas ainsi que pendant la nuit, quitter son laboratoire et abandonner son esprit aux faits ordinaires de la vie. Le problème que je poursuivais ne m’avait pas donné de ces congés. Il fallait être toujours prêt aux expériences ; il fallait, fuyant toute distraction, se tenir constamment à l’affût des phénomènes innombrables et compliqués qui surgissent dans ce qu’on appelle une intrigue amoureuse.
Aussi je profitai de ce répit au travail ardu. Sûr de mes subordonnés, j’oubliai un instant, dans les bals de barrières, dans les maisons de plaisir recommandées, cette tension intellectuelle ininterrompue que j’avais religieusement subie pour la plus grande gloire de science.
En revenant, dans le wagon, je me félicitais intérieurement de mon œuvre colossale accomplie. Je me disais, justement, que mon mémoire serait un colossal coup de tam-tam dans le monde savant, quelque chose comme les Principes de Newton ou toute autre révélation analogue.
Une si louable opiniâtreté, pensai-je, en me reposant sur les coussins de la voiture qui de la gare me conduisait à la villa, et le désintéressement de frais si considérables va enfin trouver sa récompense !
« Madame est sortie depuis trois jours, me dit-on, quand je fus chez moi.
— Sortie depuis trois jours ! Ce n’est pas possible...
— Elle a laissé une lettre pour monsieur. »
Voici la lettre :
Vous seriez un misérable, monsieur, si vous n’étiez pas si bête.
Oh ! comme je m ’ennuyais chez mes parents depuis mes études au Conservatoire ! Vous n’avez pas compris que j’ai été bien heureuse de vous trouver pour sortir de la baraque paternelle. Merci tout de même, cher ami.
Jules W***, votre ami, m’avait expliqué vos projets.
Il faut que vous soyez bien jeune, sans en avoir l’air, pour croire que c’est là ce qu’on apprend avec les femmes.
À propos, j’ai trouvé tous vos instruments, tous vos registres. J’étais nerveuse (pourtant vous m’êtes bien indifférent !) et j’ai tout cassé, tout brûlé.
J’ai même découvert le mystère du scapulaire que vous m’aviez laissé. Vos thermomètres, vos hygromètres (c’est le mot, je crois), autant de mouchards, sont en miettes.
Et puis, quels renseignements auriez-vous eus d’après moi sur l’amour ? Vous m’avez toujours ennuyée au possible... Votre ami Jules m’avait amusée et peut-être émue, avec ses audaces bohémiennes. Vous, jamais...
Il faisait trop triste dans vos boudoirs à trucs.
Adieu, mon petit savant. Je vais me dégourdir sur les planches, à l’étranger. Un grand seigneur russe, moins sérieux et plus sensible que vous, m’emporte dans sa malle.
Virginie.
Tous mes espoirs de gloire anéantis, six cent mille francs (les trois quarts de ma fortune) dépensés en pure perte, la science retardée, en cette question, de plusieurs siècles : tel est le tableau qui me passa devant l’esprit à la lecture de cette lettre. N’en voulant rien croire, je parcourus la villa de la cave au grenier.
Désastre effroyable ! tout, en effet, était brisé, pilé sous les talons de ses bottines ; les documents brûlés voltigeaient çà et là comme un essaim de papillons noirs.
Et, dernière raillerie de la fatalité, je sentis en marchant dans ces chambres vides, parmi les ruines de mon avenir, je sentis le regret de la fuite de Virginie ! Oui, je regrettais cette femme plus que mes meilleurs travaux perdus ! Et j’allai m’évanouir, ô honte, en m’enfouissant dans l’oreiller pour y retrouver l’odeur des cheveux que je ne devais plus toucher.
Pour comble, perdant l’occasion d’enregistrer les éléments analytiques d’un si profond déchirement, d’un ensemble si particulier de sensations violentes, je ne pensai pas à m’appliquer le cardiographe !
Il peut être mis en parallèle avec L'ève future de Villiers de l’Isle-Adam sur certains de ses aspects.
Le texte reproduit ici provient du site http://www.florilege.free.fr
[quote]
La Science de l’amour
Très jeune, j’eus une belle fortune et le goût de la science. Non de cette science en l’air qui, prétentieuse, croit pouvoir créer le monde de toutes pièces et voltige dans l’atmosphère bleue de l’imagination. J’ai pensé toujours, d’accord avec la cohorte serrée des savants modernes, que l’homme n’est qu’un sténographe des faits brutaux, qu’un secrétaire de la nature palpable ; que la vérité conçue non dans quelques vaines universalités, mais dans un volume immense et confus, n’est abordable partiellement qu’aux gratteurs, rogneurs, fureteurs, commissionnaires et emmagasineurs de faits réels, constatables, indéniables ; en un mot qu’il faut être fourmi, qu’il faut être ciron, rotifère, vibrion, qu’il faut n’être rien ! pour apporter son atome dans l’infinité des atomes qui composent la majestueuse pyramide des vérités scientifiques. Observer, observer, surtout ne jamais penser, rêver, imaginer ; voilà les splendeurs de la méthode actuelle.
C’est avec ces saines doctrines que je suis entré dans la vie ; et, dès mes premiers pas, un projet merveilleux, une vraie aubaine scientifique m’est venue à l’esprit.
Quand j’apprenais la physique, je me suis dit :
On a étudié la pesanteur, la chaleur, l’électricité, le magnétisme, la lumière. L’équivalent mécanique de ces forces est ou sera sans conteste déterminé d’une façon rigoureuse. Mais tous ceux qui travaillent à l’expression de ces éléments du savoir futur n’ont dans le monde qu’un piètre rôle.
Il est d’autres forces que l’observation sagace et patiente doit soumettre à l’esprit du savant. Je ne ferai pas de classifications générales, parce que je les considère comme funestes à l’étude et que je n’y entends rien. Bref, j’ai été amené (comment et pourquoi, je ne sais pas) à entreprendre l’étude scientifique de l’amour.
Je n’ai pas un physique absolument désagréable, je ne suis ni trop grand ni trop petit, et personne n’a jamais affirmé que je fusse brun ou blond. J’ai seulement les yeux un peu petits, pas assez brillants, ce qui me donne un aspect d’hébétude utile dans les sociétés savantes, mais nuisible dans le monde.
De ce monde, d’ailleurs, malgré tant d’efforts méthodiques, je n’ai pas une connaissance bien nette, et c’est un vrai chef-d’œuvre de sang-froid que d’y avoir pu, sans attirer l’attention, poursuivre mon but austère.
Je m’étais dit : Je veux étudier l’amour, non comme les Don Juan, qui s’amusent sans écrire, non comme les littérateurs qui sentimentalisent nuageusement, mais comme les savants sérieux. Pour constater l’effet de la chaleur sur le zinc, on prend une barre de zinc, on la chauffe dans l’eau à une température rigoureusement déterminée au moyen du meilleur thermomètre possible ; on mesure avec précision la longueur de la barre, sa ténacité, sa sonorité, sa capacité calorique, et on en fait autant à une autre température non moins rigoureusement déterminée.
C’est par des procédés aussi exacts que je me proposai (projet remarquable à un âge si tendre — vingt-cinq ans à peine) d’étudier l’amour. Difficile entreprise.
Généralement, je ne sais par quelle répugnance gênante et même coupable les gens amoureux se soustraient obstinément à tout examen scientifique ; et cela particulièrement dans les instants où l’examen serait fructueux. Ceci acquis, mon plan fut bien vite arrêté.
Pour étudier l’amour, me dis-je, il faut prendre le meilleur poste d’observation. Le confident le plus intime est congédié lors des minutes caractéristiques. Il n’y a que les meubles, quelquefois un chien, un chat, qui assistent à ces mystères qu’une inexplicable fatalité a dérobés jusqu’ici à l’analyse. Je n’ai donc qu’une ressource, c’est de jouer personnellement le rôle d’amoureux.
N’ayant guère de charmes, vu que le peu qui m’en avait été accordé par la nature s’était étiolé à l’ombre des bibliothèques et aux odeurs des laboratoires, j’eus recours à mon profond savoir pour me rendre digne des rêves féminins.
Oh ! les merveilleux cosmétiques, rouge puéril insoluble, noir bleuâtre des yeux sans sommeil, huiles pour rendre la peau diaphane, galvanisations pour me donner du galbe aux jambes, que j’ai inventés, à cette époque ! Mais je n’étais pas assez naïf pour compter seulement sur l’aspect de ma physionomie, sur l’allure de ma personne. Il me fallait apprendre à fond ces riens charmants qui séduisent les jeunes filles, ces futilités ridicules qui nous soumettent le beau sexe.
J’allai trouver Chopin et lui demandai :
« Vous avez beaucoup joué du piano dans le monde. Quelle est la musique qui plaît le plus aux femmes ? »
Il me répondit sans hésiter : « La Rêverie de Rosellen. »
— Quarante mille francs, si vous voulez m’enseigner à jouer parfaitement cette rêverie.
Chopin, ridiculement impratique, se récusa et me recommanda M. K***, un de ses élèves, comme plus fort que lui-même (ce qui était reste vrai). M. K*** accepta les quarante mille francs, et, probe, m’apprit uniquement à jouer la Rêverie de Rosellen.
J’étais armé de ce côté.
J’allai trouver Musset et lui demandai : « Quelle est la poésie plaît le plus aux femmes ? »
Musset posa l’index sur le sourcil et me dit : « L’Acrostiche. »
— Voici cinquante mille francs, apprenez-moi l’Acrostiche.
Musset, bohème indécrottable, ne comprit pas que j’étais sa providence et me renvoya à M. W*** (je ne veux pas révéler son nom), élève que je trouve bien plus fort que son maître.
W*** prit les cinquante mille francs et me fit une exquise collection d’acrostiches, sur tous les noms du martyrologe féminin. Chaque nom avait trois versions, blonde, brune et châtaine. Il y eut en outre promesse écrite de livraison pour les cas imprévus. Ainsi muni, j’entrai résolument dans le monde.
Après de nombreux insuccès (tant il est vrai qu’on n’apprend rien que par expérience), insuccès inutiles à raconter, je trouvai enfin mon affaire. Ce fut dans une famille habitant le Marais, dans un de ces vieux hôtels de président du Parlement.
Tout le premier étage servait de magasin de papier, et par le grand escalier de pierre à rampe patiemment forgée on montait d’interminables marches jusqu’à l’étage supérieur, où habitait M. D*** et sa famille. L’aspect honnête, oublié, de cette maison me plut tout d’abord la première fois que j’y vins.
M. D*** avait cédé au mari de sa fille aînée le magasin de papier d’au-dessous. Autrefois, la plume à l’oreille et l’œil aux ballots, il y avait acquis une fortune assez ronde pour assurer une dot raisonnable à sa fille cadette, tout en se gardant de quoi irriter les espérances de ses gendres.
On recevait tous les samedis. De toutes petites réceptions, thé, petits gâteaux, etc. C’était pour marier la fille qu’on se livrait à ces joies simples, et qu’en outre, les autres soirs de la semaine, on promenait ladite fille dans toutes les maisons du même monde. J’avais parcouru un nombre immense de ces intérieurs, sautant consciencieusement au bruit des polkas et des quadrilles que les mamans complaisantes font suinter de leurs doigts mous. Comme on me rencontrait partout, je sus me faire inviter chez M. D***. J’avais déterminé, par une suite d’examens comparatifs, que la complexion de Mlle D*** était, plus que celle de toute autre jeune fille proposée, convenable à mes projets.
La position était excellente. On me recevait en vue d’un mariage possible ; on faisait donc attention à moi, on me mettait en relief, adroitement, de manière à ne pas rebuter le caractère peut-être fantasque de la jeune personne.
Mais j’avais mon plan arrêté. Comme il est de notoriété ancienne que le mariage n’a aucun rapport avec l’amour, il fallait manœuvrer pour éviter cette conclusion désastreuse qui m’avait déjà été offerte souvent et que j’avais fuie, non sans me compromettre un peu.
Je commençai donc par donner quelques conseils à la mère au sujet de son embonpoint exagéré, cela dans les limites de la politesse la plus exquise et même de la plus candide bienveillance, bien entendu.
Ces conseils lui firent prendre une voix aigre-douce et provoquèrent une profession de foi politique pour laquelle je pris quelques réserves. Je m’en tins là cependant, ne voulant pas hâter les choses, et je me mis à causer, l’air un peu triste et préoccupé, avec la demoiselle. Je m’arrêtais au milieu de phrases dont le diable, pas plus que moi, n’eût trouvé la suite :
« Il y a des cas où l’âme doit planer au-dessus des complexités... »
Ou bien :
« Le cœur est un esclave dont la chaîne... Le cœur est un esclave qui ne saurait obéir..., etc. »
Puis, après un soupir, j’allais m’asseoir au piano et l’irrésistible Rêverie de Rosellen me valait de délicieux regards de soumission par-dessus l’épaule de la jeune personne versant le thé.
Elle s’appelait Virginie et était châtaine. Ma collection d’acrostiches contenait ce cas particulier sous la forme qu’on va lire :
Vous ne connaissez pas tous nos rêves de fièvre
Indomptable où le feu qui brûle notre lèvre
Rend la vie impossible en ces salons railleurs.
Grâce pourtant à vos regards (j’en suis comme ivre,
Ivre d’azur profond), je me reprends à vivre,
Naïf, aimant les bois. Si nous étions ailleurs,
Il faudrait oublier famille, honneur, patrie,
Et penser que je suis tout cela, ma chérie.
Ces vers, corrigés par mon ami le poète W*** d’après la situation, se prêtaient merveilleusement à mes projets de détournement. Dès que je les eus adroitement glissés dans la main droite de Virginie, la pauvrette fut désormais soumise à ma puissance.
Un soir, en prenant ma tasse de thé, je pressai ses petits doigts par-dessous la soucoupe. Émotion, ou peut-être intention de ma part, la tasse tomba, se cassa sur le coin du piano, et le thé bouillant, sucré, avec son nuage de lait, inonda mon superbe pantalon gris perle.
« Maladroit que je suis ! dis-je en palissant sous la brûlure, insignifiante du reste. Je vous ai perdu votre robe, mademoiselle.
— Tu n’en fais jamais d’autres, Virginie, dit la mère.
— Madame, je vous assure que c’est moi, en posant la tasse sur le bord du piano...
— D’ailleurs, la bonne peut offrir le thé et les sirops. »
La jeune fille disparut. Oh ! si j’avais pu assister à la nuit qu’elle dut passer !
Bref, je pondérai si bien mes faits et gestes que la froideur des parents crût exactement comme l’amour de la fille. Subséquemment j’eus des mots à voix basse avec celle-ci : elle était malheureuse, ses parents me détestaient... il fallait les ménager, etc.
J’ai l’air de faire du roman, mais on se tromperait en me croyant une pareille légèreté d’esprit. Ce que j’ai dit, aussi brièvement que possible, était nécessaire. Maintenant la science proprement dite commence.
Nous échangeâmes nos portraits. Le mien était photographié sur émail, encadré d’or, avec une chaînette minuscule, pour être porté sous les vêtements.
Ce portrait contenait, cachés entre une plaque d’ivoire et l’émail deux thermomètres à maxima et à minima, deux chefs-d’œuvre de précision sous des dimensions si petites.
Ainsi je pouvais vérifier les modifications à la température normale d’un organisme affecté d’amour.
Sous des prétextes souvent difficiles à inventer, je me faisais rendre pour quelques heures le portrait, je prenais note des nombres à leur date et j’amorçais de nouveau les thermomètres.
Un soir que j’avais dansé deux fois avec une petite dame brune, je me rappelle avoir constaté un abaissement de température de quatre dixièmes, suivi ou précédé (rien ne m’a fait connaître l’ordre des phénomènes) d’une élévation de sept dixièmes. Voilà des faits.
Quoi qu’il en soit, tout étant préparé, je pris les mesures suivantes. Je dis à M. D*** : « La propriété, c’est le vol » (ce n’est pas de moi, ce n’est pas neuf, mais ça porte toujours) ; à Mme D*** qui avait fait une fausse couche dont elle parlait trop souvent : « La femme, au point de vue économique et social, peut et doit être considérée comme une usine à fœtus » et je fredonnai, sur l’air Près d’un berceau, quelques vers d’une chanson de W*** intitulée : Près d’un bocal :
... Je le voyais en blanc faux col
Frais substitut aux dignes poses...
S’il n’était pas dans l’alcool,
Comme il eût fait de grandes choses !
Puis j’insinuai dans la main de Virginie ce billet :
« Je vous expliquerai tout, après. Brouille absolue entre vos parents et moi. L’idéal, le rêve, le prisme de l’impossible, voilà ce qui nous attend. Pour vivre il faut aimer... Il y a une berline en bas : viens, ou je me tue et tu es damnée. »
C’est ainsi que je l’enlevai.
Les facilités que j’avais trouvées dans cette entreprise me stupéfiaient, lorsqu’en chemin de fer je regardais cette jeune fille, élevée tranquillement, destinée peut-être à quelque employé médiocre, et qui me suivait à la faveur d’une série de formules sentimentales, que je n’avais pas inventées, du reste, et que vraiment j’expliquerais insuffisamment.
Nous allions quelque part, on le suppose.
J’avais en effet depuis longtemps préparé, avec ma sagacité personnelle, une délicieuse et méthodique installation dont le but apparaîtra ci-dessous.
Il y avait trois heures de chemin de fer, beaucoup de temps pour l’effarement, les sanglots, les palpitations. Heureusement que nous n’étions pas seuls dans le compartiment.
J’avais préalablement étudié, autant qu’il se peut, la situation dans les romans :
« Tu... Vous me sacrifiez tout.. Comment reconnaître... » Puis après un silence : « Je t’aime, je vous aime... Oh ! les voyages avec la bien-aimée ! L’horizon rougit le soir, ou le matin s’emperle à l’aurore, et l’on est tous deux face à face, après la distraction ou le sommeil, dans des pays à parfums nouveaux. »
Je m’étais fait faire la phrase par mon ami le poète W***.
Nous arrivons, elle comme un oiseau mouillé, moi ravi du succès initial de mes recherches. Car, sans me laisser entraîner à la vanité romanesque de cet enlèvement, j’avais durant tout le voyage, en rassurant la pauvre jeune fille effarouchée, adroitement appliqué entre sa dixième et sa onzième côte un cardiographe à fonctionnement prolongé si exact que M. le Docteur Marey, à qui j’en dois la description idéale se l’était refusé par économie.
Puis, une voiture nous prit à la gare. Terreur, embarras, ivresse inquiète de la demoiselle. Faiblement repoussés, mes embrassements permettaient au cardiographe d’enregistrer les expressions viscérales de la situation.
Et dans le délicieux boudoir où, mettant ses mains sur ses yeux, elle se reprochait sa rupture définitive avec les exigences de la morale et de l’opinion, je pus heureusement procéder à la détermination exacte (le moment était d’absolue importance) du poids de son corps. Voici comment :
Elle s’était laissée aller sur un sofa, perdue en ses pensées. M’arrêtant, ému, ravi de la contempler, je pressai du talon un bouton de sonnerie électrique ménagé sous le tapis, et, à côté, dans un cabinet secret, au bout du levier de bascule dont le sofa occupait l’autre bout, Jean (domestique dévoué et prévenu) put constater le poids de la demoiselle habillée.
Je me jetai à côté d’elle et je lui prodiguai toutes les consolations possibles, caresses, baisers, massage, hypnotisme, etc., consolations pourtant non définitives, vu mon plan de recherches.
Je passe sur les transitions qui m’amenèrent à faire tomber ses derniers vêtements, toujours sur le sofa, et à l’emporter dans l’alcôve où elle oublia famille, opinion, société.
Pendant ce temps-là, Jean pesait les habits laissés, bas et bottines compris, sur ledit sofa, de manière à obtenir par soustraction le poids net du corps de la femme.
D’ailleurs, dans la chambre où, ivre d’amour, elle s’abandonnait à mes transports fictifs (car je n’avais pas à perdre mon temps), nous étions comme dans une cornue. Les murs doublés de cuivre empêchaient tout rapport avec l’atmosphère ; et l’air, à son entrée d’abord, à sa sortie ensuite, était analysé d’une manière rigoureuse. Les solutions de potasse des appareils à boule révélaient, heure par heure, à d’habiles chimistes la présence quantitative de l’acide carbonique. Je me souviens de nombres curieux à ce sujet, mais ils manquent de la précision justement exigée dans les tables, puisque ma respiration à moi, non amoureux, était mêlée à la respiration de Virginie, vraie amoureuse. Qu’il me suffise de mentionner en gros l’excès d’acide carbonique lors des nuits tumultueuses où la passion atteignait ses maxima d’intensité et d’expression numérique.
Des bandes de papier de tournesol habilement distribuées dans les doublures de ses vêtements m’ont révélé la réaction constamment très acide de la sueur. Puis les jours suivants, puis les nuits suivantes, que de nombres à enregistrer sur l’équivalent mécanique des contractions nerveuses, sur la quantité de larmes sécrétées, sur la composition de la salive, sur l’hygroscopie variable des cheveux, sur la tension des sanglots inquiets et des soupirs de volupté !
Les résultats du compteur pour baisers sont particulièrement curieux. L’instrument, qui est de mon invention, n’est pas plus gros que ces appareils que les bateleurs se mettent dans la bouche pour faire parler Polichinelle, et qu’on désigne sous le nom de pratique. Dès que le dialogue devenait tendre et que la situation s’annonçait comme opportune, je mettais, en cachette, bien entendu, l’appareil monté entre mes dents.
J’avais eu jusque-là assez de dédain pour ces expressions de « mille baisers » qu’on met à la fin des billets amoureux. Ce sont, me disais-je, des hyperboles passées dans la langue vulgaire, d’après certains poètes de mauvais goût, comme Jean Second, par exemple. Eh bien, je suis heureux d’apporter une vérification expérimentale à ces formules instinctives que bien des savants avaient, avant moi, considérées comme absolument chimériques. Dans l’espace d’une heure et demie à peu près, mon compteur avait enregistré neuf cent quarante-quatre baisers.
L’instrument placé dans ma bouche me gênait ; j’étais préoccupé de mes recherches, et d’ailleurs les activités feintes n’égalent jamais les réelles. Si l’on tient compte de tout cela, on verra que ce nombre de neuf cent quarante-quatre peut être souvent dépassé par les gens violemment amoureux.
Cette exquise période de bonheur pour elle et de fructueuses études pour moi dura quatre-vingt-sept jours. J’avais établi la série de faits décisifs sur lesquels la science de l’amour doit nécessairement se fonder, sauf la neuvième et dernière partie dans ma subdivision. Cette neuvième partie a pour titre : Les effets de l’absence et du regret.
L’étude devenait délicate ; heureusement que je pouvais compter sur Jean (domestique dévoué) et sur mes fidèles préparateurs, physiciens, chimistes, naturalistes.
« Virginie, dis-je donc un matin, rêve bleu de ma vie, étoile de mon avenir blafard, j’ai oublié dans tes bras quelques billets à ordre qu’on a protestés. Je dois donc momentanément me soustraire aux lueurs de tes yeux, au magnétisme de tes baisers, à l’éblouissement de tes étreintes, et aller laver cette tache de ma vie commerciale. »
La scène qu’elle me fit compléta ce que j’avais déterminé dans quelques scènes précédentes relativement au Mécanisme du dépit.
Et je partis, inflexible, non sans laisser des instructions précises à tous mes préparateurs pour qu’ils prissent les dernières notes nécessaires à mon mémoire, dont l’effet académique s’annonçait désormais comme devant être foudroyant.
À dire vrai pourtant, j’étais fatigué de ces recherches si patientes. Quand un chimiste étudie avec la plus grande ferveur un genre de réactions, une théorie générale, il peut du moins, aux heures de repas ainsi que pendant la nuit, quitter son laboratoire et abandonner son esprit aux faits ordinaires de la vie. Le problème que je poursuivais ne m’avait pas donné de ces congés. Il fallait être toujours prêt aux expériences ; il fallait, fuyant toute distraction, se tenir constamment à l’affût des phénomènes innombrables et compliqués qui surgissent dans ce qu’on appelle une intrigue amoureuse.
Aussi je profitai de ce répit au travail ardu. Sûr de mes subordonnés, j’oubliai un instant, dans les bals de barrières, dans les maisons de plaisir recommandées, cette tension intellectuelle ininterrompue que j’avais religieusement subie pour la plus grande gloire de science.
En revenant, dans le wagon, je me félicitais intérieurement de mon œuvre colossale accomplie. Je me disais, justement, que mon mémoire serait un colossal coup de tam-tam dans le monde savant, quelque chose comme les Principes de Newton ou toute autre révélation analogue.
Une si louable opiniâtreté, pensai-je, en me reposant sur les coussins de la voiture qui de la gare me conduisait à la villa, et le désintéressement de frais si considérables va enfin trouver sa récompense !
« Madame est sortie depuis trois jours, me dit-on, quand je fus chez moi.
— Sortie depuis trois jours ! Ce n’est pas possible...
— Elle a laissé une lettre pour monsieur. »
Voici la lettre :
Vous seriez un misérable, monsieur, si vous n’étiez pas si bête.
Oh ! comme je m ’ennuyais chez mes parents depuis mes études au Conservatoire ! Vous n’avez pas compris que j’ai été bien heureuse de vous trouver pour sortir de la baraque paternelle. Merci tout de même, cher ami.
Jules W***, votre ami, m’avait expliqué vos projets.
Il faut que vous soyez bien jeune, sans en avoir l’air, pour croire que c’est là ce qu’on apprend avec les femmes.
À propos, j’ai trouvé tous vos instruments, tous vos registres. J’étais nerveuse (pourtant vous m’êtes bien indifférent !) et j’ai tout cassé, tout brûlé.
J’ai même découvert le mystère du scapulaire que vous m’aviez laissé. Vos thermomètres, vos hygromètres (c’est le mot, je crois), autant de mouchards, sont en miettes.
Et puis, quels renseignements auriez-vous eus d’après moi sur l’amour ? Vous m’avez toujours ennuyée au possible... Votre ami Jules m’avait amusée et peut-être émue, avec ses audaces bohémiennes. Vous, jamais...
Il faisait trop triste dans vos boudoirs à trucs.
Adieu, mon petit savant. Je vais me dégourdir sur les planches, à l’étranger. Un grand seigneur russe, moins sérieux et plus sensible que vous, m’emporte dans sa malle.
Virginie.
Tous mes espoirs de gloire anéantis, six cent mille francs (les trois quarts de ma fortune) dépensés en pure perte, la science retardée, en cette question, de plusieurs siècles : tel est le tableau qui me passa devant l’esprit à la lecture de cette lettre. N’en voulant rien croire, je parcourus la villa de la cave au grenier.
Désastre effroyable ! tout, en effet, était brisé, pilé sous les talons de ses bottines ; les documents brûlés voltigeaient çà et là comme un essaim de papillons noirs.
Et, dernière raillerie de la fatalité, je sentis en marchant dans ces chambres vides, parmi les ruines de mon avenir, je sentis le regret de la fuite de Virginie ! Oui, je regrettais cette femme plus que mes meilleurs travaux perdus ! Et j’allai m’évanouir, ô honte, en m’enfouissant dans l’oreiller pour y retrouver l’odeur des cheveux que je ne devais plus toucher.
Pour comble, perdant l’occasion d’enregistrer les éléments analytiques d’un si profond déchirement, d’un ensemble si particulier de sensations violentes, je ne pensai pas à m’appliquer le cardiographe !